 Denis Labayle
Denis Labayle
Éditions Julliard (2004)
294 pages
20 euros
« J’aimerais tant que tous les responsables politiques lisent Parfum d’ébène, leçon de réalisme, leçon d’humilité, leçon d’humanisme. »
Kofi Yamgnane – Ancien ministre de la République
Prix du Lions Club International, Paris, 2005
Présentation / presse
Commander le livre
Extraits
Pages 67 à 69
« … Quand une brise souleva enfin l’air chaud, je sortis de ma léthargie et partis explorer la ville dans l’espoir de le rencontrer. C’était absurde, bien sûr ! Mais je ne pouvais nier le désir qui m’habitait.
Je pris la direction d’un quartier que je n’avais pas encore exploré. Une zone plus incertaine. Je pénétrai dans un dédale de ruelles bordées de cabanes en tôle et en carton, de paillotes en palmes de cocotier. Je préférais ne pas imaginer ce qui pouvait rester de ces abris après le passage d’un cyclone. Les rares habitations en parpaings, bruts de béton, n’étaient pas les moins surprenantes avec leurs tiges métalliques tendues vers le ciel dans l’espoir d’une extension. Partout, des immondices refoulés dans les coins ou au fond des culs-de-sac. Je croisais des êtres en guenilles adossés à des murs blessés : aveugles, morceaux d’hommes exposant leurs difformités au soleil et à la pitié des rares passants. Corps sans membres, membres sans pieds, visages sans regard. Là, un unijambiste couché sur le sol, tendant en guise de sébile un moignon creusé par la lèpre. Un peu plus loin, un groupe de culs-de-jatte rampant au ras du sol, tels des cafards. Ici s’exposait le monde des parias, des inactifs faméliques qui quémandaient une pièce pour subsister. Ici, l’humanité meurtrie se disloquait, perdait tout repère. Pas d’eau, pas d’égout. Des remugles de pourritures et un silence impressionnant que seuls troublaient les cris des corbeaux. Je sentais qu’aucune règle, aucune loi ne pourraient arrêter la main de celui qui me planterait son couteau dans les reins juste pour me dérober les quelques billets froissés dans ma poche. J’en vins même à lui donner raison tant ma bonne santé devait susciter incompréhension et violence.
J’eus tout à coup l’impression, en passant devant les habitations, d’être observé par des yeux invisibles qui attendaient que je me perde dans ce labyrinthe où chaque passage pouvait déboucher sur une voie sans issue. Je me hâtai, me retournant à plusieurs reprises pour vérifier que personne ne me suivait. Rien. Et pourtant, j’eus la certitude d’une présence. Il me sembla même apercevoir une ombre furtive qui disparut aussitôt. Peu à peu, la peur m’envahit. Peur de me trouver confronté à une volonté destructrice dont j’ignorais tout, jusqu’au visage. Etait-il seul ou s’étaient-ils mis à plusieurs pour me tendre un traquenard ? Je pressai le pas, virai à droite puis à gauche pour semer mes poursuivants, mais je revins involontairement sur mes pas : le labyrinthe où je m’étais hasardé semblait sans issue et propice à une confrontation où tout devenait possible, jusqu’à ma disparition. Les appels au secours ne serviraient à rien. Qui viendrait aider un inconnu assez stupide pour franchir les limites de la prudence ? Jamais je ne m’étais senti si étranger. La panique me tortura le ventre. Par un réflexe de survie j’eus le désir de faire front, de me battre, d’affronter l’inconnu, de jouer le tout pour le tout. Je m’engageai dans une ruelle sombre et me réfugiai dans l’embrasure d’une porte. J’attendis, une pierre à la main. Dans mon dos ruisselait une sueur glaciale. Bientôt une silhouette se détacha de la blancheur des murs, passa de porte en porte. Je n’avais pas rêvé. J’eus le temps de le reconnaître à sa démarche souple. C’était lui, j’en étais sûr. Je laissai tomber ma pierre et m’apprêtai à l’apostropher. J’hésitai encore un moment avant de quitter mon refuge mais, trop tard, la forme s’était effacée dans l’ombre d’une habitation »
Page 191 à 194 : une des lettres envoyées par Damien à sa sœur
« Ma chère Hélène
J’ai trouvé ta lettre à mon retour de Macunda. Son ton m’a surpris. Serais-tu jalouse de mon bonheur ? L’amour que je vis n’altère en rien l’affection que je te porte et doit laisser intacte notre complicité. Tu me reproches à plusieurs reprises mon silence, mais n’avons-nous pas vécu pendant des années dans un autre silence, plus redoutable encore, qui évitait de nous interroger sur nous-mêmes ? Ces dernières semaines ont bouleversé ma vie comme un cyclone. Et j’en parle en connaissance de cause pour avoir assisté récemment à une colère de la nature dont je n’avais jamais imaginé la violence. Le cyclone amoureux est plus surprenant encore que cette tornade. Loin de me détruire, il m’a fait sortir du silence étouffant dans lequel nous nous complaisions depuis des années. Notre malheur nous unissait, mais cette union a entretenu notre isolement. Nous n’avons pas seulement subi la malédiction familiale, nous l’avons cultivée.
Tu te plains de la rareté de mes lettres. Il est vrai que tu m’écris plus souvent, mais pour dire quoi ? Tu m’évoques le temps à Paris, le dernier film que tu as vu ou tes difficultés relationnelles avec l’un ou l’autre de tes collaborateurs, mais je t’en prie, parle-moi de toi, de l’essentiel, de ce qui gouverne ton existence. Tu as été ma confidente, mais moi, qu’ai-je été pour toi ? Tu as toujours gardé une distance et je me rends compte aujourd’hui que ta vie m’est étrangère. Je ne sais rien de tes souffrances secrètes. Tu m’as dit avoir eu des amants, mais sans me parler d’eux ou presque. Tu m’as fait partager tes dépits amoureux, sans m’en donner les raisons.
Souviens-toi, tu venais chaque fois dans ma chambre te blottir dans mes bras en quête de consolation et quand je te questionnais, tu me répondais invariablement : « Parlons d’autre chose. » Je finissais même par te soupçonner d’inventer des ruptures pour te réfugier chez moi. Ah, Hélène, qui es-tu ? La femme raisonnable que j’ai toujours connue aurait-elle tout ignoré des joies de l’enfance et des folies de l’adolescence ?
Aujourd’hui, j’en suis convaincu, si nous avons su partager notre souffrance, je ne t’ai apporté qu’un bonheur malheureux qui n’est pas le vrai bonheur. Si je suis parti, c’est aussi pour nous sortir, toi comme moi, de cette sclérose sentimentale dans laquelle nous nous enfermions.
Ici, j’ai rencontré un autre bonheur, différent, plus fort, même s’il se présente plus fragile et plus angoissant aussi. Je partage ma vie avec une personne qui me fait chaque jour découvrir une part inconnue de moi-même. Pour la première fois, mon existence devient surprise, étonnement, découverte. Si tu m’aimes vraiment, alors réjouis-toi, car ton frère bien-aimé n’est plus l’individu pitoyable qu’il était.
Tu écris dans ta lettre que je m’éloigne. Je le reconnais : Paris me semble loin. Tous les détails qui ont rythmé mon quotidien s’effacent peu à peu de mon esprit. J’en oublie jusqu’aux immeubles de notre rue et aux bureaux du quartier des Invalides où j’ai sacrifié tant d’années. Ils représentent aujourd’hui pour moi l’image de l’ennui.
Mais sache que, toi, je ne t’oublierai jamais.
A part cela, lors de mon dernier passage à Macunda, je n’ai pas progressé dans l’enquête sur la mort de notre père. Pire, les cyclones ont, à plusieurs reprises, ravagé le cimetière. S’il est enterré là-bas, la nature a emporté définitivement son secret. Nous ne pourrons plus localiser sa tombe, ni rapatrier son corps.
Je me demande si notre projet est encore justifié. Je ne sais ce que notre père a fait de sa vie. Quelle était sa relation amoureuse avec notre mère ? Quel père il a été pour nous ? Peut-être avons-nous idéalisé un être qui n’a jamais existé. Aujourd’hui, quand je pense à lui, je l’imagine plus complexe et finalement plus humain. Il est temps que nous devenions à la fois plus lucides et plus tolérants. Nous voyons chez les autres la facette qui nous rassure ou nous convient. Si demain tu débarquais dans ma vie, saurais-tu reconnaître le frère que tu as connu ? Nous gardons tous un jardin secret, mélange de rêve et de réalité.
Je te joins un croquis de Macunda après le passage du cyclone. Il ne peut malheureusement rendre compte de la violence dont j’ai été témoin. Je t’embrasse tendrement.
Ton frère Damien qui n’a jamais cessé de t’aimer. »
 Denis Labayle
Denis Labayle Pitié pour les hommes
Pitié pour les hommes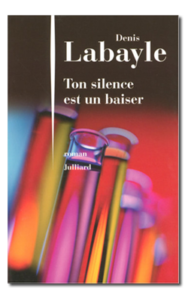
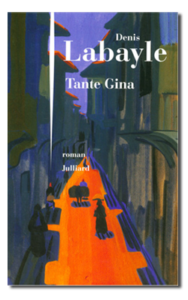
 Denis Labayle
Denis Labayle Denis Labayle
Denis Labayle